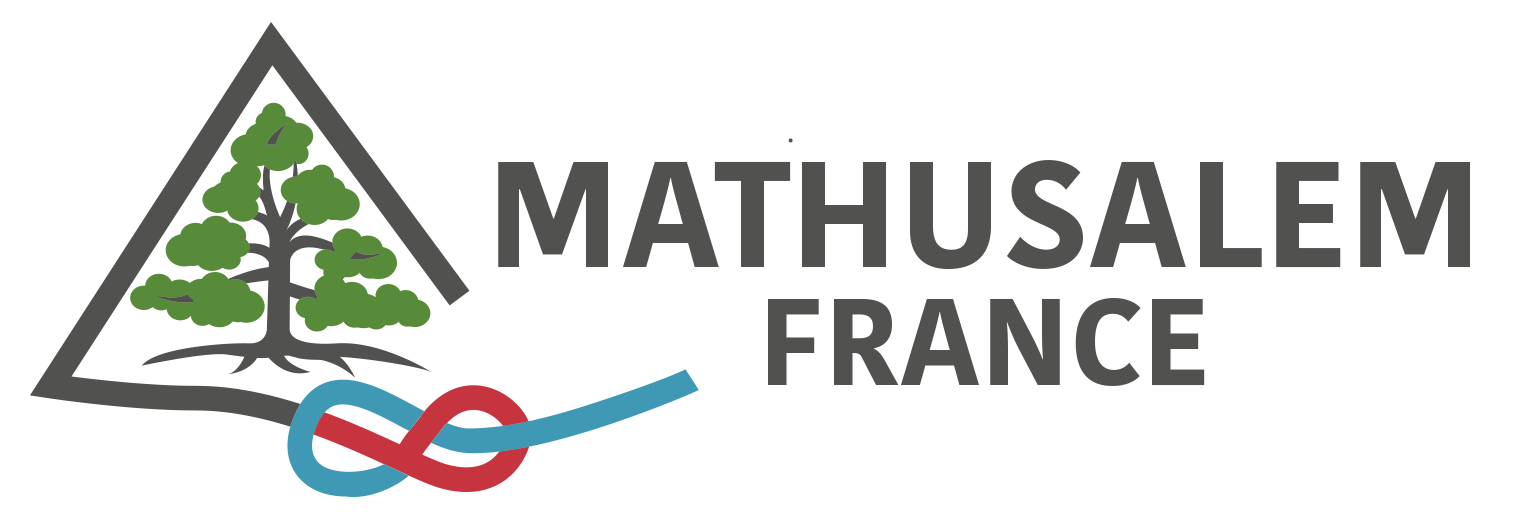Avant 17h, la nuit est déjà tombée, et les visages font grise mine. Certains ressentent même les symptômes de la dépression saisonnière. Mais pourquoi le soleil, source d’inspiration philosophique, a-t-il tellement d’influence sur nos vies ?
Pas trop le moral en ce moment ? Comme une envie d’hiberner sous la couette en attendant des jours meilleurs ? Ce blues hivernal est courant : le soleil se fait la malle et notre moral avec. La dépression saisonnière (ou trouble affectif saisonnier) est pourtant un trouble psychiatrique reconnu, affectant jusqu’à 10% de la population française. Démarrant généralement à la fin de l’automne, les symptômes incluent déprime, perte d’intérêt, modification de l’appétit, troubles du sommeil et idées noires, avant de s’estomper au printemps. Ce diagnostic souligne l’influence de la lumière – et de son absence – sur nos vies, nos émotions, notre santé mentale. Comme le montre l’enseignante en philosophie Emma Carenini dans son ouvrage Soleil. Mythes, histoire et sociétés (Le Pommier, 2022), les rayons du soleil ont toujours été au centre de la pensée philosophique, à la fois comme objet d’étude et comme point de vue : « Il y a une pensée faite au soleil, qui n’est pas la même qu’ailleurs. » Une « pensée méditerranéenne », solaire, que Paul Valéry décrivait comme une « sensibilité intellectuelle particulière » liée à la clarté de l’horizon. Nous ne faisons pas la même expérience du monde lorsque les jours raccourcissent et que la lumière vient à manquer. De fait, la dépression saisonnière n’est pas seulement une affection psychologique : elle est aussi une angoisse existentielle.
La lumière, c’est la santé !
Parmi les causes de la dépression saisonnière, la modification du rythme biologique provoquée par la diminution de la lumière. Pas de panique : un traitement existe. La luminothérapie, consistant à s’exposer à une lampe reproduisant la lumière blanche du soleil, permet de voir son état s’améliorer sous quelques jours. Une méthode qui n’aurait pas manqué d’intéresser Hippocrate, père de la médecine occidentale. Dans son Traité des Airs, des Eaux et des Lieux, il recommande au médecin s’installant en ville d’« examiner sa position et ses rapports avec les vents et avec le lever du soleil ». L’exposition à la lumière naturelle joue un rôle central dans la bonne santé. « Les villes qui sont dans une belle exposition par rapport aux vents et au soleil » sont moins sujettes aux maladies. Chacun a donc la possibilité de guérir dans des conditions naturelles optimales. Une conception largement reprise par le courant naturaliste au XVIIIe siècle, inspiré par la philosophie vitaliste, qui met en avant le lien entre environnement et santé. Cette « médecine naturiste », si elle n’a rien à voir avec les pratiques de nos amis nudistes, fait du soleil « l’élément central d’une nouvelle médication naturelle ». Contre la conception mécaniste et cartésienne du corps, il s’agit de mettre en avant le rôle joué par les conditions naturelles dans le développement ou la prévention des maladies.
Sous le soleil artificiel
Pour Emma Carenini, la popularité de la médecine naturiste au cours de la révolution industrielle européenne n’est pas un hasard. Du fait de la surpopulation, les grandes villes se construisent à la verticale : les immeubles de plus en plus hauts réduisent considérablement l’ensoleillement des rues et des maisons. Les technologies modernes, notamment la production de lumière artificielle, nous ont fait penser que nous pouvions nous émanciper du rythme cosmique. « L’âge industriel se serait ainsi érigé “contre” le jour, au profit de la machine. » L’imaginaire de la ville moderne est celui d’un lieu sombre, encombré, parcouru par l’obscurité et la fumée des usines. Ainsi l’écrivain britannique Charles Dickens décrit-il Manchester, en Angleterre, comme un hiver perpétuel : « Il est 3 heures de l’après-midi et déjà, il fait nuit. Aucun souffle ne provient du large. Dans la rue, les bâtiments tremblent et résonnent tout le jour au rythme d’énormes pistons. Le travailleur regarde l’horloge, un peu las. » Dès le XIXe siècle, l’accès à la lumière naturelle devient un enjeu de santé publique. Dans le cadre des politiques hygiénistes, les pathologies urbaines sont directement reliées aux mauvaises conditions de vie, parmi lesquelles l’air saturé et l’obscurité. « On comprit ainsi que la ville moderne, par définition, s’opposait au soleil ». Impossible de maintenir un espace suffisant entre les bâtiments pour laisser circuler les rayons, ou d’offrir une exposition correcte à chaque habitant. En ce sens, la dépression saisonnière ne serait pas tant un mal saisonnier qu’un mal moderne. Elle met en avant le caractère désormais rare, donc luxueux, de l’accès à la lumière.
L’angoisse de la nuit
Que faire quand la lumière nous échappe ? Pour certaines sociétés humaines du passé, le lever du soleil n’avait rien d’une évidence. Ainsi, les éclipses solaires étaient la source d’une profonde terreur, pour les Incas ou les Mayas : le soleil se serait endormi et risquerait d’être dévoré par un puma. Il fallait alors faire du bruit pour effrayer le félin. On regardait cette boule de feu disparaître, rongé par l’appréhension : « Le soleil allait-il revenir de son séjour chez les morts ? La lumière allait-elle ressurgir ? » La raréfaction de la lumière naturelle nous confronte à une angoisse similaire. Une peur peut-être encore renforcée par nos connaissances scientifiques. Les observations de Galilée contredisent la description aristotélicienne du soleil comme parfait et immuable. Nous savons désormais que c’est un astre qui vieillit et est amené à disparaître. Pour le philosophe Jean-François Lyotard, cette conscience de la finitude du système solaire et de l’homme en tant qu’espèce confine au vertige existentiel. Dans Moralités postmodernes (Galilée, 1993, rééd. 2005), il décrit la future explosion du soleil comme la seule question philosophique valable, celle qui marquera la fin de la grande fable humaine : comment affronter l’idée que la présence des hommes sur Terre ne soit qu’un passage, puisque celle-ci sera amenée à se dissoudre sans laisser de traces ? La lumière tardant à revenir nous confronte à la vacuité. Et si elle ne revenait jamais ? Car un jour, elle disparaîtra. Dans 4,5 milliards d’années, précisément. Avec elle, toutes nos questions, nos passions, nos pensées. Comme le rappelle Carenini, « cette fin est donc bien différente de la fin du monde annoncée par les prophètes ou par le discours écologiste ; on n’y trouvera aucune issue possible ».
La dépression nous plonge donc dans l’angoisse, l’impression d’un vide de sens, la perspective de la mort. Une mélancolie semblable à la conscience de cette fin des fins, d’un jour qui ne se lèvera plus jamais. Qu’elle se déclenche ou s’accentue quand la nuit vient nous envelopper n’aurait donc rien d’un hasard : « La fin de la lumière est le début de l’impensé humain. »
Pas sûr qu’une lampe de luminothérapie suffise à lutter contre un tel désespoir. Peut-être nous faut-il alors également tourner nos pensées vers des contrées plus ensoleillées. Car il existe bien une « pensée de midi », remède à l’absurde, selon Albert Camus. Une philosophie tragique, ambiguë et cependant positive, tournée vers l’action. En 1957, recevant le prix Nobel de littérature, il l’affirme : « Je n’ai jamais pu renoncer à la lumière, au bonheur d’être. »
Source Philosophie Magazine