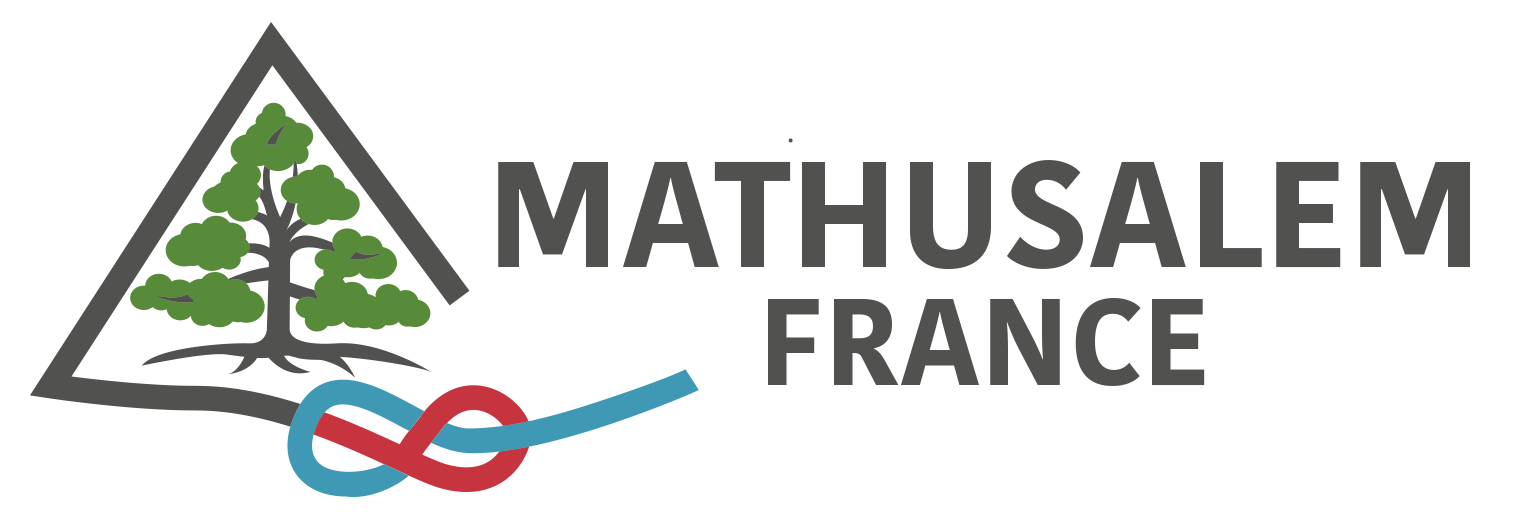l y a cent quarante ans, était promulguée une législation majeure pour la démocratie : la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, encore en vigueur de nos jours à part quelques modifications de détail.
Cette loi s’inscrivait dans une séquence historique d’extension de la démocratie et des libertés impulsée par les gouvernements républicains « opportunistes » des années 1880 : loi du 30 juin 1881 permettant de tenir les réunions publiques sans autorisation, sur simple déclaration préalable, loi du 4 mars 1882 donnant à tous les conseils municipaux le droit d’élire leur maire, ou bien encore loi de Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884 instaurant la liberté syndicale.
Une loi du gouvernement Jules Ferry
Le texte du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse apparaît comme une consécration. Car si cette liberté était déjà reconnue dans l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, elle avait été bien souvent mise à mal depuis la Révolution.
a législation votée sous le ministère de Jules Ferry définit les libertés et responsabilités de la presse. Elle impose un cadre légal à toute publication, ainsi qu’à l’affichage public, au colportage et à la vente sur la voie publique. Son article 1 stipule que « l’imprimerie et la librairie sont libres ». Mais pour en arriver là, sans de grandes remises en cause par la suite, le chemin a été long et semé d’embûches, jalonné par des flux et des reflux.
La liberté d’expression a été perçue comme un danger par tous les régimes politiques et longtemps aussi par l’Église. Surtout depuis que l’invention de l’imprimerie au XVe siècle par Gutenberg développa la diffusion des ouvrages, des journaux, des libelles et des illustrations de toutes sortes, et que la Réforme luthérienne remit en cause les dogmes de l’Église catholique.
C’est au début du XVIe siècle qu’une série d’ordonnances et d’édits royaux soumet tout livre traitant de religion à une autorisation préalable et charge de cet examen la Faculté de théologie de Paris.
En août 1544, celle-ci établit une première liste manuscrite de 230 livres déconseillés, sous le nom d’Index librorum prohibitorum. On y trouve Pantagruel et Gargantua de Rabelais, interdits pour cause d’obscénités ! À l’occasion du concile de Trente, le Saint-Siège reprend l’idée à son compte et publie en 1559 l’Index romain.
La presse et l’imprimerie sous haute surveillance
Au siècle suivant, le cardinal Richelieu, principal ministre de Louis XIII, organise une surveillance systématique de l’écrit afin d’interdire ou freiner la multiplication des écrits hostiles au pouvoir. De 1624 à 1653, aucun ouvrage ne peut être ainsi publié sans un « privilège du roi » qui accorde à un imprimeur, et à lui seul, l’autorisation de reproduire un texte.
Un service de censeurs est créé qui examine le contenu de chaque livre avant qu’une décision ne soit prise concernant sa publication ou ne soit demandé à l’auteur d’apporter des modifications ou de réaliser des coupures dans son texte. Cette agence institutionnelle de la monarchie s’appelle la Librairie et se trouve abritée dans les bureaux du chancelier. À la veille de la Révolution, elle emploie encore plus d’une centaine de censeurs. Ces derniers tirent leur nom des magistrats de la Rome antique qui devaient veiller au maintien des bonnes mœurs (dico).
Les censeurs modernes doivent veiller à ce que la religion, la moralité, l’État, le roi, le gouvernement ou des compatriotes ne soient pas bafoués dans des livres très divers sur la religion, les belles-lettres, l’histoire, la géographie, la politique, le droit, les sciences et la médecine.
Ce système perdurera jusqu’à la Révolution. Avec plus ou moins d’efficacité car les auteurs, notamment les philosophes des Lumières faisaient souvent éditer leurs œuvres à l’étranger avant qu’elles ne parviennent clandestinement en France où elles étaient diffusées sous le manteau. Et puis ce régime de censure comportait des souplesses. « Permissions tacites », « tolérances », « permissions simples », « permissions de police », les fonctionnaires chargés de la Librairie conçurent toute une gamme de catégories utilisables pour permettre aux livres de paraître sans obtenir d’approbation officielle », écrit l’historien américain Robert Darnton (De la censure, Gallimard, 2014).
Pas toujours convaincus par la pertinence de leur tâche, les censeurs procédaient à des arrangements avec des auteurs. Ainsi, de 1750 à 1763, le plus célèbre directeur de la Librairie, Malesherbes, pensait « qu’un homme qui n’aurait lu que des livres parus avec l’attache expresse du gouvernement, comme la loi le prescrit, serait en arrière de ses contemporains presque d’un siècle ». Il a même caché à son domicile des textes de l’Encyclopédie recherchés par la police…
Tout change avec la Révolution. Profitant de la confusion politique, plus de 1300 journaux et gazettes apparaissent, de façon souvent éphémère. Mais la liberté de la presse a beau être proclamée, elle n’est pas toujours respectée comme le montre la saisie du Vieux Cordelier de Camille Desmoulins ou celle du Tribun du peuple de Gracchus Babeuf, ainsi que l’emprisonnement ou l’exécution de journalistes.
Après dix ans de révolution, le Premier Consul Bonaparte, qui mesure mieux que quiconque l’importance du verbe, instaure un contrôle strict de la presse. Il rétablit la censure le 17 janvier 1800. Le nombre de journaux quotidiens est limité à onze par un arrêté. Il sera encore réduit à quatre en 1811.
La surveillance des journaux ne se relâche pas avec la chute de Napoléon Ier et la Restauration de la monarchie, malgré l’article 8 de la Charte constitutionnelle de 1814 qui reconnaît la liberté de la presse : « Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté. » Inlassable défenseur de la liberté de la presse, François-René de Chateaubriand fait la leçon aux gouvernements répressifs : « Plus vous prétendez comprimer la presse, plus l’explosion sera forte. Il faut donc vous résoudre à vivre avec. »
Sans liberté de presse, une révolution !
Sous la Restauration, les journaux parisiens ne se vendent que par abonnnement et totalisent guère plus de 60 000 exemplaires. Mais c’est assez pour toucher toute la bourgeoisie instruite avec une influence certaine sur les affaires politiques. C’est pourquoi le gouvernement du roi Charles X les a à l’oeil. Les principaux titres de la presse libérale sont Le Constitutionnel, fondé en 1815, Le Temps, Le Globe, Le Figaro, fondé en 1826, ainsi que Le National, né en janvier 1830 à l’initiative de Thiers, Mignet et Carrel, avec le soutien du banquier et député Jacques Laffitte.
Le point d’orgue de la répression survient suite à l’arrivée du prince de Polignac à la tête du gouvernement, en août 1829. Un an plus tard, le 25 juillet 1830, à Saint-Cloud, cet ultra convainc le roi de signer quatre ordonnances, dont la première suspend une nouvelle fois la liberté de la presse : « La liberté de la presse périodique est suspendue. L’autorisation préalable des journaux est une nouvelle fois rétablie. Cette autorisation pourra être provisoirement accordée et provisoirement retirée par les préfets. Les presses et caractères qui auront servi à l’impression des feuilles interdites seront mis hors de service. Les écrits publiés sans autorisation seront immédiatement saisis. »
Les rédacteurs de journaux signent une protestation qui fait grand bruit le 26 juillet : « Dans la situation où nous sommes placés, l’obéissance cesse d’être un devoir. […] Aujourd’hui donc, des ministres criminels ont violé la légalité. Nous sommes dispensés d’obéir. » C’est le signal de l’insurrection. Paris se soulève. Cette Révolution des Trois Glorieuses aboutit à remplacer le très autoritaire Charles X par son cousin, le libéral Louis-Philippe.
La nouvelle Charte constitutionnelle stipule que « les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois »et restaure la liberté de la presse. L’abaissement du cautionnement et des taxes suscite un développement important des journaux. Mais cette embellie s’avère de courte durée car l’attentat de Fieschi contre Louis-Philippe, le 28 juillet 1835, donne l’occasion au pouvoir de porter le fer contre la presse à travers la « loi scélérate » du 9 septembre 1835 qui soumet les dessins et gravures à l’autorisation préalable, prohibant ainsi toute critique à l’égard du gouvernement.
La « Monarchie de Juillet » évolue dès lors vers l’autoritarisme et l’impopularité jusqu’à l’abdication de Louis-Philippe et l’avènement de la Seconde République en février 1848. Comme en 1789 et en 1830, l’élan révolutionnaire provoque en 1848 une floraison de journaux et de feuilles politiques.
Mais avec l’élection de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence de la République le 10 décembre 1848 puis avec la proclamation du Second Empire, s’ouvre une période plus sombre pour la presse qui doit subir toute une série de mesures de contrôles (cautionnement, timbres, avertissements, etc.).
C’est à cette époque que des satiristes représentent la censure en une vieille femme tenant d’énormes ciseaux et surnommée Anastasie.
La presse n’est pas la seule forme d’expression victime de la censure. Des œuvres littéraires sont aussi dans le viseur de la police et de la justice. En 1857, trois écrivains, Gustave Flaubert, Charles Baudelaire et Eugène Sue sont traînés devant les tribunaux. Le premier, accusé d’outrage à la morale publique et à la religion dans Madame Bovary est finalement acquitté. En revanche, le second se voit condamné pour les mêmes raisons à retirer six poèmes des Fleurs du mal et écope d’une amende de 300 francs.
Quant à Eugène Sue -son cas est moins connu-, il meurt traumatisé à l’idée de passer en justice, et les 60 000 exemplaires des Mystères du peuple sont saisis et condamnés pour avoir dépeint la profonde misère du peuple de Paris. Entre régime autoritaire et ordre moral, les premières années du Second Empire malmènent la liberté d’expression. Ce qui fera dire à Flaubert : « La censure quelle qu’elle soit, me paraît une monstruosité, une chose pire que l’homicide : l’attentat contre la pensée est un crime de lèse-âme. »
La libéralisation du régime à partir des années 1860 favorise l’autorisation de nouveaux titres et conduira progressivement à l’avènement de l’Âge d’or de la presse sous la Troisième République qu’amplifiera la loi du 29 juillet 1881. Mais si le statut de la liberté de la presse est alors défini, il est loin d’être stabilisé car les aléas de la politique et de l’Histoire l’entameront avec le retour de la censure lors de la Première Guerre mondiale (c’est le « bourrage de crâne » que dénonce le Canard Enchaîné) mais aussi, plus gravement, sous l’Occupation allemande, enfin encore pendant la guerre d’Algérie.
Précaire liberté, nouveaux défis
Méfiant malgré tout à l’égard des citoyens, surtout quand ils disposent d’une plume, d’un micro ou d’un clavier, le législateur n’a pas manqué d’amender la loi de 1881.
La loi Pleven du 1er juillet 1972, relative à la lutte contre le racisme crée ainsi un nouveau délit et punit la discrimination, l’injure ou la diffamation à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elle permet à des associations de se porter partie civile, ce qui va susciter nombre d’abus.
La loi Gayssot du 13 juillet 1990 sanctionne quant à elle la négation de la Shoah et des crimes contre l’humanité perpétrés par le régime nazi.
L’émergence d’Internet et des réseaux sociaux suscite de nouvelles adaptations de la loi. La lutte contre la diffusion de bobards (fake news en langage branché) s’est traduite par deux lois concernant la manipulation de l’information pendant les périodes de campagne électorale. Promulguées en décembre 2018, elles autorisent un candidat ou un parti à saisir le juge des référés pour faire cesser la diffusion de fausses informations durant les trois mois précédant un scrutin national.
Par ailleurs, le Conseil supérieur de l’audiovisuel détient le pouvoir de suspendre ou d’interrompre le temps de la période électorale la diffusion d’une chaîne de télévision contrôlée ou placée sous influence d’un État étranger, et portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.
Mais le législateur a voulu aussi protéger la presse des pressions économiques. À la Libération, l’ordonnance du 26 août 1944, a ainsi interdit les concentrations d’organes de presse. Quarante ans plus tard, s’est ajoutée la loi dite « anti-Hersant ».
Enfin, la législation du 1er août 1986 a réformé le régime juridique de la presse en interdisant « l’acquisition d’une publication quotidienne d’information politique et générale ou la majorité du capital social ou des droits de vote d’une entreprise éditant une publication de cette nature, lorsque cette acquisition aurait pour effet de permettre à l’acquéreur de détenir plus de 30% de la diffusion totale sur l’ensemble du territoire national des quotidiens d’information politique et générale ».
Une menace nouvelle plane sur la liberté de la presse depuis quelques années, celle du terrorisme islamiste, comme l’a montré l’attentat meurtrier du 7 janvier 2015 contre Charlie Hebdo.
Plus largement, la liberté d’expression est remise en cause dans des universités françaises, par des petits groupes d’activistes employant des méthodes nées aux États-Unis dans le cadre de la cancel culture. Ainsi en 2019, les comédiens de la pièce de théâtre Les Suppliantes d’Eschyle à Sorbonne Université ont été empêchés de rentrer dans l’amphithéâtre par un groupuscule qui reprochait au metteur en scène de maquiller ses comédiens en noir, l’accusant même de « propagande coloniale ».
L’intervention de la philosophe Sylviane Agacinski à l’université Bordeaux-Montaigne sur le thème de « l’être humain à l’époque de sa reproductibilité technique » a dû être annulée en raison de menaces de violences d’associations étudiantes locales reprochant à la philosophe d’être opposée à la Procréation médicale assistée (PMA) pour toutes. L’ex-président François Hollande qui devait tenir une conférence à l’université de Lille, en a été empêché par l’envahissement de l’amphithéâtre par une centaine de personnes s’insurgeant contre la précarité étudiante ; des exemplaires de son livre ont été déchirés.
Il ne s’agit là que de quelques exemples significatifs. Preuve que la liberté d’expression, quelle que soient ses déclinaisons -celle de la presse en est une-, constitue un droit et un bien qui ne sont pas définitivement acquis dans les régimes démocratiques. Et que la vigilance reste encore et toujours de mise pour les protéger.