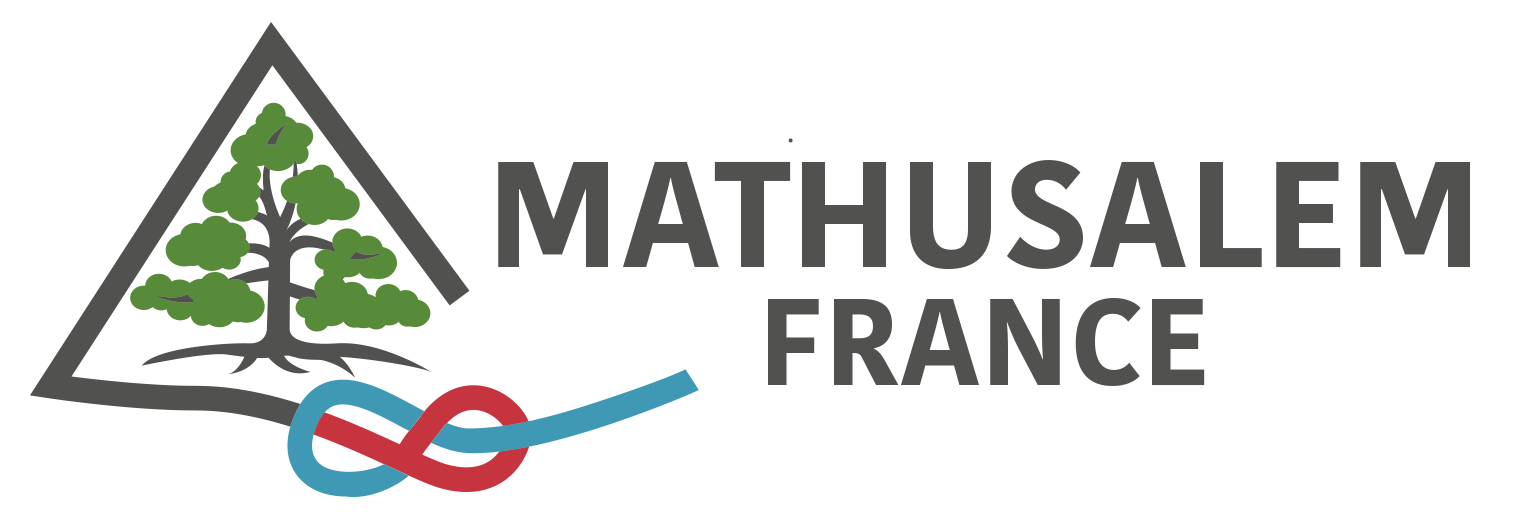CHRONIQUE. La mort d’Elizabeth II nous rappelle que nos deux pays sont liés. Le Brexit et la mauvaise foi de certains dirigeants ne doivent pas le faire oublier.
Au XVIe siècle, le poète anglais Sydney qualifiait la France de « sweet enemy », notre « gentil (ou tendre) ennemi ». Tout était dit de cette relation d’amour-haine qui devait le plus souvent opposer et parfois rapprocher les deux voisins. Deux siècles de paix et deux guerres mondiales combattues côte à côte, une appartenance commune à l’Union européenne et une coopération exemplaire dans le domaine de la sécurité paraissaient avoir définitivement laissé derrière nous les querelles du passé. Je peux témoigner, en tant que représentant permanent de la France au Conseil de sécurité des Nations unies, qu’il n’y avait pas de délégation plus proche de la nôtre que la britannique. Non seulement nos intérêts mais nos analyses et même nos méthodes étaient proches.
En tout cas, même s’il ne l’avouait pas volontiers, mon homologue travaillait mieux avec le Français qu’avec l’Américain. Il est vrai que beaucoup d’éléments impalpables confortaient cette coopération : la Grande-Bretagne et la France ont été des puissances mondiales et partagent donc, à la fois, une vision globale de la politique étrangère et une connaissance approfondie de la plupart des problèmes du monde ; elles savent également tempérer leurs élans d’un réalisme de bon aloi et, enfin, elles ne se paient pas de mots. Après mille ans de disputes et de retrouvailles, nous nous comprenons à demi-mot.
C’est donc avec désolation que j’ai vu le Brexit polluer, comme il était prévisible, les relations bilatérales franco-britanniques bien au-delà des seules questions européennes. À Londres, il fallait trouver un coupable pour expliquer que, loin de se diviser comme on l’y espérait, l’UE restait unie pour refuser au Royaume-Uni de bénéficier des avantages du marché unique sans en subir les contraintes, comme l’avaient fait miroiter les partisans de la sortie de l’Union. Or, à Paris, nous prenions la tête des opposants aux demandes britanniques. Non que ce fût indispensable d’ailleurs puisque nos partenaires partageaient nos vues, mais notre talent est de monter sur la scène dès que c’est possible quitte à y recevoir des tomates.
Grâce à cette addition de mauvaise foi britannique et d’ostensible fermeté française, la presse anglaise, qui n’est pas ce dont nos voisins ont le droit d’être le plus fiers, avait donc trouvé le bouc émissaire dont elle rêvait. Tout à ses propres déchirements, la classe politique locale a évidemment suivi, et comme il est impossible de se disputer à moitié, l’ensemble de la relation bilatérale en a souffert jusqu’à entendre la nouvelle Première ministre affirmer qu’elle ne savait pas si le président de la République française était un ami ou un ennemi de la Grande-Bretagne.
« Halte au feu ! »
Quand on entend une telle absurdité, il est impératif de dire : « Halte au feu ! » Nous ne pouvons nous permettre des querelles qui en tout temps seraient dérisoires et deviennent dangereuses alors que la guerre est de retour sur notre continent. Plus que jamais, les deux pays qui détiennent les deux meilleurs appareils de défense européens doivent rester unis.
Ce n’est donc pas être sentimental que d’espérer que l’émotion que partagent aujourd’hui les Britanniques et les Français après le décès de la reine Elizabeth II puisse être l’occasion pour les deux pays de se retrouver. Elle ne se cachait pas d’aimer notre pays dont elle parlait la langue. En présentant ses condoléances, le président de la République a tenu des propos émouvants, qui reflètent les sentiments de la nation.
La main est tendue. À nos amis britanniques d’y répondre ou non. Or, depuis la conclusion de l’accord de sortie de l’UE, le contraste est grand entre, d’un côté, le déchaînement francophobe des déclarations officieuses et officielles outre-Manche et, de l’autre, le silence qui y est opposé en France. Là est sans doute le plus grand obstacle : pour les Français et au-delà pour les autres membres de l’UE, le Brexit est un fait accompli ; les accords doivent être mis en œuvre ; d’autres problèmes beaucoup plus importants doivent être réglés. À Londres, le Brexit reste le sujet du jour tant il crée de difficultés d’ailleurs prévisibles ; la recherche de culpabilité si elle doit épargner les politiciens qui en ont été les agents ne peut alors que se porter sur l’interlocuteur européen, ce qui vise en premier chef celui qui a la mauvaise idée d’être, avec l’Irlande, le plus proche géographiquement.
Tant que l’hypothèque de Brexit ne sera pas levée, rien de plus difficile que cette réconciliation que j’appelle de mes vœux. Soyons-en conscients mais faisons tout pour y parvenir. Du côté français, au moment où risque de se rallumer la querelle du protocole sur l’Irlande du Nord, pourquoi ne pas éviter de monter sur nos grands chevaux et laisser la Commission, dont c’est la fonction, conduire la négociation ? Laissons à d’autres le rôle du « méchant ». En d’autres termes, face à un interlocuteur qui a perdu son bon sens légendaire, n’en ajoutons pas et explorons même discrètement les possibilités de compromis. Pour une fois, soyons les pragmatiques que les Britanniques ne savent plus être. L’Entente cordiale vaut bien ça. Si les deux pays s’engageaient demain dans cette voie, nous aurions une raison de plus d’être reconnaissants à la reine Elizabeth pour tout ce qu’elle a fait pour les relations entre les deux pays.